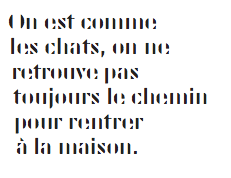Fiction sur l’œuvre de l’artiste brésilien Geraldo de Barros
In: Sobras, Geraldo de Barros
Paris: Chose Commune, 2017
Vanessa Barbara
Traduit du portugais (Brésil) par Dominique Nédellec
Je pourrais commencer en dressant l’inventaire des choses que j’ai perdues : un chemisier vert avec une broche en forme de lézard lors d’un voyage en train. Un dentifrice à la menthe après un vol intercontinental. Un petit ami, en 1982. Une chaussette. Un cachet d’aspirine. Des lentilles de contact. Les clés de la maison – elles étaient au fond du sac de courses, ce que je n’ai découvert qu’après avoir fait changer toutes les serrures.
Ça remonte à près de trente ans maintenant et plus moyen de me rappeler d’où vient la phrase «Je ne veux pas mourir à Cordeirópolis », qui, j’ignore pour quelle raison, se trouve notée dans la marge d’un cahier de français. De ma main. De même, je n’ai jamais pu tirer au clair cette histoire que quelqu’un m’a racontée au sujet d’un couple de parents qui, à titre d’expérience, avaient caché à leur fils l’existence du mot «pomme » jusqu’à ses six ans.
J’ai aussi perdu mon chat plusieurs fois. Adoniran avait la manie de se glisser dans les tiroirs, les armoires, les cartons vides et, une fois, il est resté caché toute une semaine dans le grenier de la maison. Mais un soir il s’est échappé par une porte restée ouverte et a disparu. Je devais avoir à peu près onze ans. Mes parents m’ont assuré que les chats savent retrouver leur maison et finissent toujours par revenir, mais j’ai attendu plusieurs semaines et rien. Des copains d’école – j’ignore s’ils inventaient tout ça pour me consoler – me racontaient des histoires extraordinaires de félins qui rentraient après avoir disparu pendant des années, couverts de cicatrices et un œil en moins à cause des bagarres – des histoires arrivées au voisin du cousin de quelqu’un qu’ils connaissaient, mais visiblement Adoniran n’appartenait pas à cette catégorie-là. Des mois se sont écoulés. J’ai gagné un petit frère aux cheveux châtains, un bébé grassouillet qui passait ses journées à téter. J’ai aussi retrouvé une lentille de contact desséchée sous une chaise de la cuisine, mais aucune trace d’Adoniran.
Un jour, il est revenu. C’était l’été, en fin d’après-midi; mon père a ouvert la porte de la maison en tenant dans ses bras un chat de gouttière, noir aux yeux verts, une boule de poils très fâchée avec un air fiérot et le regard agacé de qui n’est pas venu au monde pour recevoir des ordres. Mon père a dit qu’il l’avait trouvé dans le jardin en train de déterrer des marguerites. Ma mère, juste derrière lui, faisait craquer ses doigts comme quand elle était nerveuse. J’étais tellement heureuse que je n’ai même pas remarqué qu’il n’avait plus sa touffe de poils blancs sur le ventre et que ses oreilles étaient plus pointues qu’avant. Adoniran a aussitôt pris ses quartiers dans un coin du salon et décidé de se faire les griffes sur les pantoufles de ma mère, parfaitement indifférent à mon euphorie.
Après, même si, dans le fond, je savais bien que ce chat n’était pas Adoniran – alors que mes parents avaient espéré que je n’y verrais que du feu –, j’ai continué de l’appeler comme ça et je passais mon temps à identifier chez ce nouvel animal des traits de son ancienne personnalité : sa façon de se coucher dans le pot de fougères, ses miaulements de protestation quand il était contrarié, la manie qu’il avait de fixer le vide.
Les chats savent retrouver leur maison et finissent toujours par revenir, avaient dit mes parents. Moi, je ne voulais pas perdre Adoniran. Les chats que j’ai eus par la suite ont tous porté le même nom.
—-
Lorsque mon mari est arrivé, j’étais figée au beau milieu du salon, une cuillère à la main. Apparemment, j’étais sortie de la cuisine et je me dirigeais vers la chambre, mais, en chemin, je me suis mise à penser aux tatous ; dès lors, toute la question de savoir ce qu’il convenait de faire de cette cuillère semble avoir été comme entièrement siphonnée, disparaissant en une poignée de secondes pour laisser à la place un espace vide, blanc, effrayant comme une pièce sans meubles.
Ça a démarré comme ça: j’étais en train de raconter une histoire et, tout d’un coup, je perdais le fil. Je montais au front au cours d’une réunion pour défendre un point qui me semblait important, mais d’un instant à l’autre je ne me rappelais plus pourquoi je disais ça ni par quoi je devais poursuivre. J’ai décidé alors de noter certaines choses, histoire qu’elles cessent de m’échapper, et de consigner mes pensées les plus triviales afin d’éviter de les perdre en route. Par exemple, si j’avais besoin d’aller chercher un tournevis dans le débarras, il y avait de grandes chances pour qu’en chemin je me laisse distraire par une assiette sale dans la salle à manger et décide de bifurquer dans l’idée d’aller la laver, mais en me dirigeant vers la cuisine je pouvais aussi bien me cogner le petit orteil contre n’importe quoi et me souvenir qu’il était temps de me couper les ongles, puis sur ces entrefaites sursauter à cause d’une alarme de voiture dans la rue – si bien que je me retrouvais dans la salle de bains une assiette sale à la main sans avoir la moindre idée de ce que je fabriquais là. Par conséquent, lorsque j’avais à accomplir une tâche dont l’exécution pouvait prendre plus de trois secondes – ou nécessiter un changement de pièce –, je prenais aussitôt un stylo et notais sur un bout de papier : « Tournevis.» J’avais toujours le pense-bête sur moi, dans la poche avant de mon bermuda, de sorte qu’un matin quelconque la liste pouvait donner ceci: «Me laver la figure », «Me faire les yeux (crayon)», «Ne pas sortir sans alliance », «Vider la poubelle de la salle de bains », «Remplir le filtre à eau», «Prendre un parapluie ».
Mais, ça, ce n’était que le début. Ce jour-là, mon mari s’est contenté de me prendre la cuillère des mains et a engagé la conversation comme si rien d’anormal n’était arrivé, comme on fait avec les enfants lorsqu’ils menacent d’éclater en sanglots et qu’il faut rapidement les distraire avec une craie de cire ou un chou cabus. Il semblait ne pas vouloir s’inquiéter de l’incident; peut-être lui était-il déjà arrivé la même chose. Peut-être n’était-ce pas la première fois qu’il me trouvait figée au beau milieu du salon avec une cuillère.
Les épisodes d’amnésie se sont peu à peu multipliés. J’avais une chose en tête – par exemple, l’objet qu’on utilise pour retirer un œuf de la poêle ou le nom de l’acteur qui joue Spider-Man – et j’étais tout simplement infichue de la nommer. Je sentais que l’information était là, quelque part dans mon esprit, mais je ne savais pas quel chemin emprunter pour y accéder. J’ouvrais une porte et c’était un tas d’autres choses que je trouvais stockées là, par exemple le prénom de cette tante portugaise qui portait des robes à fleurs (Cremilda), mon ancien numéro de téléphone, ou alors je me mettais à penser fixement à un batteur électrique, à un ouvreboîte. Je fermais les yeux, retenais ma respiration et tentais d’extirper physiquement le mot en question de tout un fatras de souvenirs, mais en vain. La seule solution était de renoncer et de demander autour de moi, au risque de passer pour quelqu’un de franchement bizarre («Cet objet avec des petits trous, vous savez? Avec un manche comme ça »). Ce n’est que comme ça que je retrouvais enfin ma bienheureuse écumoire.
Très vite, tout le monde a su que j’avais la mémoire qui flanchait. Cependant, au début, les choses me revenaient. Je sentais que l’information existait, j’avais les mots sur le bout de la langue et je savais qu’il suffisait d’actionner un détail pour que tout s’éclaire. Mais, plus tard, ça aussi je l’ai perdu. Cette sensation de malaise avec la pièce sans meubles a cessé d’être une présence pour n’être plus qu’absence, et c’est seulement à travers les autres que je prenais conscience qu’il y avait de grands espaces vides dans ma mémoire.
Des espaces remplis d’une matière qui ressemblait à de la neige.
—-
L’érosion est inévitable et progresse à vive allure. Entre le dernier trait et maintenant, j’ai de nouveau perdu l’écumoire, mais j’ai trouvé amusante cette femme qui fait des listes pour se souvenir de remplir le filtre à eau.
Comme je n’ai pas la moindre idée de ce que j’avais prévu d’écrire par la suite, j’ai décidé, avant que la compréhension des mots ne m’échappe complètement, de me consacrer à l’enregistrement d’un seul épisode – celui que je voudrais voir disparaître en dernier, et dont je garde encore en mémoire quelques fragments épars. Je m’en contenterai jusqu’à la totale dissolution de l’ultime morceau de moi-même. Ce sont les souvenirs de mon dernier hiver avec mon frère.
—-
Je ne me rappelle plus si c’était en Suisse ou en France, seulement que ça s’est passé au milieu des années 1970. Pour Noël, j’avais reçu une belle combinaison orange ou bleue, je ne sais plus, et des bottes chaudes et confortables. Je rêvais depuis toute petite de voir la neige. Nous voilà donc partis – mes parents, mon petit frère et moi – dans un chalet loué pour la saison, ce qui signifie probablement que ma famille était très riche, ou que mon père était un militaire corrompu, ou que j’étais un mannequin international. Je me souviens bien de ce que j’ai ressenti en voyant la neige tomber pour la première fois. Au début, on aurait dit des pellicules venues du ciel, ou une infinité de petites plumes blanches lancées du haut d’un immeuble. On se serait cru sur une autre planète. J’avais l’estomac noué, comme dans un ascenseur panoramique: plus la neige tombait, plus j’avais l’impression qu’on montait vite. La neige a recouvert les montagnes, les arbres, le toit du chalet, les marches, enveloppant tout d’un blanc molletonné. Quand je ferme les yeux, j’arrive encore à retrouver ces sensations : mes pieds qui s’enfoncent, l’air pur, le froid coupant qui transperce mes couches de vêtements jusqu’à la dernière.
Cet hiver-là, à bientôt dix-neuf ans, j’ai vu la neige pour la première fois. J’ai également essayé d’apprendre à skier – une catastrophe. Mon frère, lui, toujours bon en sport, a réussi en un clin d’œil à se débrouiller et à dévaler les pistes – avec des skis plus grands que lui, les lunettes sur le front et ce regard confiant qu’on peut avoir à tout juste neuf ans. «Il suffit de se jeter vers l’avant, comme ça », et il filait, tandis que je restais bloquée, avec la frousse de bouger et de me casser la figure encore une fois. Je faisais tout mon possible, respirais à fond à chaque tentative, mais systématiquement je me mettais à paniquer et je tombais. Au bout de quelques jours, j’ai fini par renoncer ; je me contentais de rester au bord du lac, à lire un roman policier ou à observer mon frère qui, désormais, apprenait aux autres enfants comment il fallait s’y prendre et arrivait même à doubler certains adultes.
Je ne me souviens pas si quelqu’un d’autre avait fait le voyage avec nous ; peut-être un oncle et une tante avec leurs enfants, ou alors des voisins, ou alors des collègues de travail de mon père. Ce que je sais, c’est que parmi les expériences les plus mémorables du séjour (on me pardonnera l’expression) il y a eu ce pique-nique en plein air, au pied d’un arbre qui avait encore ses feuilles, pendant lequel j’ai bu un bon chocolat chaud et mousseux avec des gens dont l’identité m’échappe (à bien y réfléchir, c’étaient peut-être mes parents). Le reste s’est perdu. Je ne me rappelle plus, par exemple, si c’était avant ou après notre départ pour le refuge. Je garde en mémoire des choses diffuses : un tas de sacs en toile de jute, un robinet difficile à ouvrir et mon frère l’air effrayé. Je me rappelle être tombée, m’être cogné la tête et avoir dû rester alitée plusieurs jours. Mais, si j’en suis certaine, c’est seulement à cause de la cicatrice que j’ai encore.
Un week-end, mes parents ont décidé d’aller faire un tour en ville et m’ont laissée seule dans le chalet pour veiller sur mon frère. Cela faisait longtemps qu’on ne s’était pas retrouvés rien que nous deux. À cette époque, j’étais déjà à la fac et je passais moins de temps avec mon cadet, et tout d’un coup j’ai pris conscience que je ne le connaissais pas si bien que ça – à moins que ce ne soit l’impression que j’ai aujourd’hui, cinquante ans plus tard, alors que son image est en train de s’effacer de mon esprit et que je ne saurais même plus dire s’il était droitier ou gaucher.
J’ai proposé qu’on parte en balade jusqu’à un refuge abandonné qui se trouvait de l’autre côté de la station, en grimpant sur la montagne à travers les arbres. «Quand on sera arrivés, on pourra construire un igloo», ai-je ajouté pour tenter de convaincre mon frère de laisser ses skis pour la journée.
On a sauté par-dessus le grillage qui délimitait la station et on s’est engagés sur le sentier qui montait vers la forêt. On progressait lentement pendant que je lui racontais une histoire censée être terrifiante – seulement, j’étais tellement nulle qu’il n’arrêtait pas de se marrer. Je me souviens que, soudain, le vent est devenu plus fort, il allait probablement se mettre à neiger et j’ai hésité, mais mon frère a insisté pour qu’on continue. D’après mes estimations, nous n’étions plus très loin du refuge. «Je parie qu’on va trouver un tas de corps entassés là-bas », a lancé mon frère comme pour me motiver. D’après lui, cet endroit était hanté par des esprits maléfiques qui attiraient de pauvres skieurs égarés. «C’est des enfants de la station qui me l’ont raconté, a-t-il expliqué, ils m’ont dit que personne n’était jamais revenu de ce refuge.»
(Gaucher, sûr, il était gaucher.)
Je ne me rappelle pas bien s’il y avait beaucoup de neige sur le sentier, ni si on a aperçu des écureuils en chemin; en revanche, je n’ai pas oublié que mon frère n’arrêtait pas de répéter tout excité, à moitié essoufflé : « Tu vas voir, quand on va ouvrir la porte, des têtes coupées avec les yeux exorbités vont dégringoler de partout et un squelette va t’attraper par les pieds.» Les nuages noirs s’amoncelaient dans le ciel, j’ai pressé le pas car il m’a semblé qu’on n’était pas à l’abri d’une tempête. J’ai sorti de mon sac à dos deux de ces couvre-chefs en laine dont j’ai perdu le nom, ainsi que des gants et des écharpes. «Personne n’arrive à sortir de là parce que quand tu claques la porte ça déclenche une avalanche, du coup tu te retrouves coincé et tu meurs de faim», a continué le petit garçon. J’ai trouvé ça amusant et je me suis demandé dans quel genre d’école il pouvait bien aller, ou quel genre de livres sa mère le laissait lire.
On a aperçu non loin un tas de pierres et une pelle plantée dans la neige ; le petit garçon a aussitôt demandé si on pouvait l’emporter avec nous pour enterrer les corps. «Non, on ne peut enterrer personne puisqu’il faudra bien qu’on mange quelques cerveaux», ai-je répondu, très sérieuse. L’idée l’a emballé. « On trouvera là-bas des petites cuillères et on se régalera avec de l’excellente cervelle », ai-je ajouté. «Et après on deviendra des zombies, a-t-il enchaîné, et on habitera dans notre igloo et on ira à la chasse aux écureuils.» On a donc laissé l’écumoire dans la neige et poursuivi notre escalade.
Plus tard, il a enterré des billes au pied d’un arbre, en m’expliquant qu’il voulait laisser un cadeau aux voyageurs qui passeraient par là après la fonte des neiges.
Voilà, pour l’essentiel, ce que je me rappelle de cette journée : notre conversation avant d’atteindre le refuge, le ciel se chargeant de nuages et le vent étendant sur nous un drap de plus en plus blanc. Une fois au sommet, avant de nous atteler à la construction de l’igloo, on est restés un certain temps à admirer le refuge. À l’intérieur, à notre grande surprise… Je ne me souviens plus de ce qu’il y avait à l’intérieur, mais, si je pouvais m’en souvenir à présent, il y aurait certainement de quoi être surpris. Je crois bien qu’on avait apporté avec nous des sandwichs au concombre. J’ai enlevé mes bottes et les ai laissées à l’entrée. Adoniran a posé son sac avant d’inspecter chaque pièce. Peut-être y a-t-il eu une tempête; peut-être a-t-on dû rester là plusieurs jours, avec rien d’autre que nos sandwichs. Ou alors j’ai vu ça dans un film. Je ne sais pas si le refuge était réellement abandonné, et je ne me rappelle pas plus ce qui s’est passé par la suite. J’ai beau fermer les yeux et tâcher de rassembler mes souvenirs, je ne vois que des murs nus, des fenêtres sans carreaux, des formes imprécises ensevelies sous la neige.
Et une orchidée – oui, je me souviens d’une orchidée. Je crois que, dans ce refuge abandonné dans la glace, à quelques kilomètres de la station de ski, il y avait un pot contenant une seule orchidée qui, j’ignore comment, avait survécu à l’hiver. Je suis restée debout à contempler ce miracle, et je m’apprêtais à dire quelque chose de poétique lorsque Adoniran est arrivé en courant et a arraché l’orchidée de sa tige, en expliquant qu’il voulait l’emporter pour l’offrir à sa mère. Avec un sourire jusqu’aux oreilles. Voilà ce que je suis en mesure de raconter. C’est tout ce qui m’est resté.
Je suis incapable de dire comment on est rentrés, ni même si on est vraiment rentrés. Ça a été mon dernier hiver avec lui, non pas qu’il soit arrivé quoi que ce soit ce jour-là – ou si, allez savoir –, mais parce que c’est le dernier hiver dont j’aie gardé le souvenir. Peu à peu, tout disparaît. Je rencontre des gens qui sont peut-être déjà morts, je ne me rappelle plus si je suis mariée ou non, je crie après les infirmières sans plus savoir pourquoi. Celle que j’ai été par le passé n’existe plus. Les êtres que j’aimais sont partis. Il ne me reste plus que les sensations de l’instant présent: la bouche pleine de chocolat, le soleil qui me brûle la peau, une jolie musique qui ne m’évoque absolument rien. Je ne sais plus si je vais mourir sans jamais avoir vu la neige.